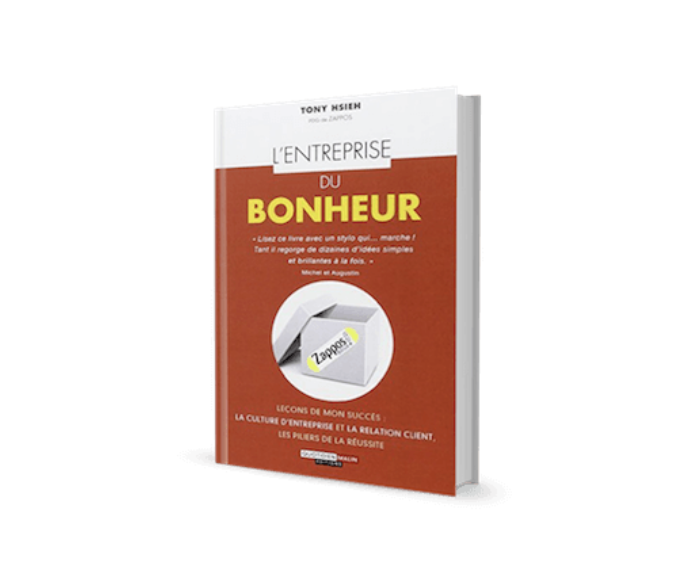SERVIR : suivre cette voie originale pour accroître son leadership
Il y a quelques jours, un de nos clients nous demande une formation pour un de ses chefs de projets autour de la thématique du leadership.
En effet, cette personne est très professionnelle, expérimentée, très bien formée techniquement à la gestion de projet, mais a du mal à engager les équipiers projet. Elle ne se sent pas « aimée » par les équipiers, ayant un comportement jugé comme trop « froid », ce qui nuit visiblement à sa performance de chef de projet et à l’avancement du projet dans son ensemble.
En préparant la formation, je me suis dit que ce serait une bonne idée de relire le best-seller de Ken Blanchard et Mark Miller « Comment développer son leadership ? » (« The Secret » dans sa version originale).
Et donc, j’en profite pour vous partager ce que j’en retiens.
De quoi s’agit-il ?
C’est un petit guide pratique qui propose en une centaine de pages aérées (60 à 80 minutes de lecture) une voie originale et puissante pour améliorer son leadership professionnel.
Raconté sous la forme d’une histoire, le livre détaille la transformation d’un leader dans une entreprise grâce au mentoring, en une année.
Que l’on soit à la tête d’une entreprise mondiale, responsable d’une équipe dans un club sportif, chef de projet dans une ETI, toute personne en situation d’autorité hiérarchique ou transverse est appelée à développer un authentique leadership, efficace et humain, qui bénéficiera à ceux qui l’entourent et à elle-même.
Le livre détaille les manières de servir qu’un leader peut mettre en œuvre. Le premier principe est que le leader n’est pas là pour commander ni pour lui-même : il est là pour servir ceux avec qui il travaille (on parle du « Servant Leadership »).
Comme toujours avec Ken Blanchard, les conseils sont aussi applicables qu’efficaces. Il s’appuie sur les recherches les plus récentes en management et sait les rendre accessibles et vivantes (il s’agit de la quatorzième édition). Kenneth Blanchard est un auteur américain spécialisé dans le domaine du management et du leadership situationnel de proximité, célèbre pour ses 18 millions d’exemplaires de livres vendus, dont « Manager Minute ». Mark Miller est directeur de la formation au sein de la chaîne de restauration rapide Chick-fil-A, qui comprend 1 100 restaurants à travers les États-Unis.
Le secret du leadership est que beaucoup de personnes font preuve en permanence d’autorité sans être en position de leadership et beaucoup d’autres personnes, qui sont en position d’autorité, n’exercent aucun leadership. Le vrai leadership n’a rien à voir avec le niveau hiérarchique. Il est lié à l’intention.
Le secret des meilleurs leaders, c’est de SERVIR.
Un bon leader se demande toujours : « Pourquoi est-ce que je pilote mon équipe ou mon projet ? »
Si je pilote avec le désir de rendre service aux autres et à mon organisation, j’aurai un comportement très différent de celle qui a l’intention de se servir.
La question essentielle à se poser en tant que leader : « Suis-je un leader qui sert ou un leader qui se sert ? »
Ken Blanchard et Mark Miller utilisent l’acronyme SERVIR pour proposer 6 principes à suivre pour être un leader efficace :
SERVIR, c’est :
- Signaler l’avenir : donner du sens, une vision à l’équipe ;
- Engager les personnes et les faire grandir (notion d’empowerment) ;
- Réinventer sans cesse : être créatif et faire évoluer les façons de faire ;
- Valoriser les résultats et les relations : ne pas choisir entre les deux ;
- Incarner les valeurs : aligner le geste et la parole pour être crédible ;
- Réfléchir toujours : un leader se forme toujours et apprend sans cesse.
1 – Signaler l’avenir :
C’est définir la vision et répondre collectivement à la question : « Où allons-nous ? »
Une vision devient « irrésistible » pour l’équipe si elle attise la passion chez les équipiers. Elle dit à tous ceux qui travaillent avec nous qui vous sommes, où nous allons et ce qui détermine nos intentions et nos actions.
Le leader a la tête à la fois « dans les nuages » et « dans les dossiers » : il ou elle regarde à la fois à l’horizon, et devant soi pour éviter les obstacles qui sont devant.
Le leader construit avec ses équipiers la direction pour anticiper les opportunités et les obstacles. En impliquant les collaborateurs dans « la tête dans les nuages », le leader facilite leur engagement. Et dans le même temps, le leader aide les personnes dans la mise en œuvre opérationnelle, pour transformer la vision en réalité.
Questions que le leader peut se poser :
- Quel est l’objectif de notre équipe ?
- Où voulons-nous que notre équipe soit dans plusieurs années ?
- Toute l’équipe est-elle capable de dire ce qu’on essaye de devenir ?
- Quelles sont les valeurs de l’équipe qui façonnent les comportements ?
- Comment pouvons-nous communiquer aux autres notre vision de l’avenir ?
2 – Engager les personnes et les faire grandir
Pour accomplir notre vision, il nous faut avoir les bonnes personnes, à la bonne place, dans le bon rôle, et pleinement impliquées. Tout ce que nous accomplirons dépend des personnes qui composent l’équipe.
Quelle est la décision la plus importante qu’un leader doive prendre ?
Peter Drucker répondait : « Déterminer qui fait quoi ».
Chaque membre de l’équipe est une intelligence disponible. Pour bénéficier de ces intelligences disponibles, il est nécessaire que chacun adhère à l’objectif et au projet. Avec le cerveau, le cœur et le corps…
Être un leader, c’est d’abord s’intéresser à comment procéder pour parvenir à conquérir la tête et le cœur des membres de l’équipe. Comprendre donc quelles sont les choses qui les motivent dans leur travail. Quelles sont les conditions qui leur permettent d’être totalement engagés ?
Nous pouvons citer :
- Avoir des buts clairs et explicites ;
- Être bien informé en disposant de l’information dont on a besoin
- Avoir la confiance de son leader, se sentir valorisé et apprécié
- Bénéficier de la présence du leader quand on en a besoin
- Se sentir utile
- Apprendre et grandir ensemble
- Délimiter clairement ses responsabilités
- Réfléchir par soi-même plutôt que d’être un simple exécutant : apporter son cerveau au travail ☺
- Être évalué sur nos résultats et non sur qui on est
Engager les autres, cela veut dire selon Peter Drucker : « Le but du leader est de renforcer les forces des personnes et de rendre leurs faiblesses anodines. »
Questions à se poser :
- Combien de temps passons-nous à rechercher des personnes de talent ?
- Quelles sont les caractéristiques clés recherchées chez les personnes ?
- Avons-nous engagé avec succès chacun des membres de notre équipe ?
- Quelles actions particulières pourrions-nous mener pour engager davantage les membres de l’équipe ?
- De quelle manière engager les équipiers à grandir et à progresser ? Sont-ils bien formés ? Leurs compétences sont-elles évaluées régulièrement ?
- Quels sont les points forts des membres de l’équipe ? Comprennent-ils clairement leurs responsabilités ?
3 – Réinventer sans cesse
Ou dit autrement, « Comment faire mieux ? » Comment créer une dynamique d’amélioration continue permanente sur le plan personnel, au niveau des processus et de l’organisation ?
Sur le plan personnel, les meilleurs leaders sont à l’affût de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire. Ils n’arrêtent jamais d’apprendre. Pourquoi ? Pour donner l’exemple de comportement qu’il souhaite chez les autres. Apprendre continuellement permet de rester dans la course et d’évoluer continuellement, car beaucoup de réponses qui fonctionnaient par le passé ne sont plus valables aujourd’hui. Les leaders ont donc la responsabilité de cultiver et fertiliser les talents qui leur ont été donnés pour renforcer leurs forces.
Au niveau des systèmes et des processus, les leaders se posent des questions comme : « comment pouvons-nous faire mieux ce travail ? Comment pouvons-nous le faire avec moins d’erreurs ? Comment pouvons-nous le faire plus vite ? Comment pouvons-nous le faire pour moins cher ? »
Au niveau organisationnel, les leaders adaptent l’organisation à la réalité, au changement qu’ils savent permanent (Héraclite).
Questions à se poser :
- Qui sont les personnes qui m’inspirent, mes mentors ?
- Qu’est-ce que je lis ou écoute ?
- Que devons-nous arrêter de faire qui n’est plus utile ?
- Comment s’organiser différemment pour améliorer la performance ?
4 – Valoriser les résultats et les relations
Les leaders sont exigeants sur les résultats et entretiennent de bonnes relations avec les autres. Ils ou elles savent écouter, prendre le temps, prendre soin personnellement des autres, mettre l’accent sur le positif plutôt que sur le négatif.
Le leader sait valoriser les résultats et les relations sans choisir entre les deux. Il ou elle demande : « Comment puis-je t’aider ? » Car les gens ne font pas attention à ce que vous savez d’eux, sauf s’ils savent que vous faites attention à eux.
Comme le dit John Maxwell, « Les gens ne vous tendent pas la main s’ils ne voient pas votre cœur »
Allier résultats et relation nécessite d’être capable de ne pas opposer l’exigence aux bonnes relations. Ce n’est pas parce qu’on s’entend bien qu’on ne peut pas être exigeant.
Questions à se poser :
- Comment mesurer les résultats ?
- Est-ce que je connais la vie personnelle des membres de l’équipe ?
- Est-ce que je félicite régulièrement les membres de l’équipe pour leurs succès, et les recadre pour des comportements inappropriés ?
Photo de Riccardo Annandale sur Unsplash
5 – Incarner les valeurs
Les valeurs sont les croyances qui façonnent nos actions. Les valeurs de l’équipe guident chacun dans la manière d’appliquer la vision. Elles doivent être définies ensemble, rendues explicites, diffusées, reconnues et récompensées.
Aligner les actes, les paroles et les pensées avec les valeurs affichées permet de créer la confiance auprès des équipiers. S’ils n’ont pas confiance dans le leader, l’équipe n’atteindra jamais son plein potentiel.
Faire ce que je dis et dire ce que je fais plutôt que « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ».
Le leadership prend sa source dans la confiance et la crédibilité que le leader suscite, et non dans telles ou telles valeurs qui seraient « bonnes ».
Questions à se poser :
- Mon équipe a-t-elle défini ses valeurs communes ?
- Comment définir les mauvais comportements et les attitudes préférées par l’équipe ?
- Comment modifier nos comportements pour mieux correspondre à ces valeurs définies ensemble ?
- Comment pouvons-nous distinguer et récompenser les personnes qui incarnent ces valeurs ?
6 – Réfléchir toujours
Les leaders savent qu’ils ne maîtrisent pas tout. Ils se remettent en permanence en question. Cela les amène à l’humilité. En tant que leader, l’humilité de reconnaître nos mauvaises décisions et de rectifier la situation permet de garder notre crédibilité auprès de l’équipe.
Avoir aussi la capacité à former un successeur compétent ou monter l’équipe suffisamment en autonomie pour qu’elle devienne autogérée. Si le leader est indispensable, avec un management « solaire », c’est qu’il n’a pas su faire émerger d’autres leaders. Or, faire grandir l’équipe, c’est monter chacun en autonomie et en assertivité.
« Tout le monde a sa grandeur, car chacun peut rendre service. » Martin Luther King
Appliquer ces 6 principes quotidiennement dans ses activités de leader permet sans aucun doute d’augmenter son influence positive sur les autres, en les aidant, en les servant systématiquement, en leur montrant qu’un leader est là pour servir et non pour se servir.
Mais comme il n’est pas évident d’être totalement objectif, il est bien utile d’avoir une personne avec qui discuter pour réfléchir, avoir un feedback, faire le point sur les actions entreprises et les résultats obtenus. Cela donne aussi du courage pour affronter les échecs, pour faire face à des difficultés et continuer malgré tout. En clair, faites appel à un mentor, qu’il soit interne ou externe à votre organisation.
Car « On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres » Pr. Philippe Carré.
Crédit :
Photo de couverture : Photo de Brooke Lark sur Unsplash